Dans la multitude de sélections célébrant les premières œuvres de cinéastes, le festival Premiers Plans d’Angers propose avec ses « Diagonales » huit films sortant des sentiers battus. Une originalité : les courts et longs-métrages concourent ensemble au même prix, que les films fassent 1h40 ou 10 minutes. Alors que la compétition « principale » présentant des longs-métrages européens n’accueille que des fictions, la sélection présente quatre fictions et quatre documentaires — la catégorie englobant les formes proches de l’essai. Cette sélection est sans doute la plus intéressante tant elle présente des œuvres plus personnelles, plus radicales, cherchant des solutions cinématographiques pour raconter leur histoire et explorant la diversité des formes filmiques. Si l’on peut regretter que ces films ne soient pas versés dans les autres sélections, cela permet au moins au public du festival — qui ne peut décemment pas tout aller voir dans le généreux programme — d’être quasiment assuré de découvrir des films différents et originaux.
Ce qui frappe d’emblée est que cinq films sur huit de la compétition sont empreints d’un fond politique lié de près ou de loin à la Russie : une fiction sur le voyage de Piotr Kropotkine, cartographe russe découvrant l’anarchisme au coeur de la Suisse du début du XXème siècle ; le documentaire d’un cinéaste ukrainien sur son grand-père ukrainien ayant vécu l’âge d’or du cinéma soviétique ; l’enquête visuelle d’une française sur une ville ukrainienne détruite par l’armée russe ; un autre documentaire, d’une cinéaste russe sur son adolescence dans les années Poutine ; ou encore un essai reconstituant méticuleusement les méthodes de torture la police politique biélorusse. Rien de surprenant ici puisque le festival angevin met à l’honneur le cinéma européen, traumatisé par le retour de la guerre sur le continent. Onze mois après le début de l’invasion russe sur l’Ukraine, tous ces films témoignent de la variété des manières de penser la Russie dans son histoire politique comme dans sa plus brûlante actualité. Autant de manières, sinon de résister, au moins d’opposer à la guerre et à la tentation autoritaire des histoires humanistes.
Présidé par le cinéaste et producteur Vincent Le Port, le jury de la compétition était composé de la directrice de casting Youna de Peretti et de la programmatrice Anne-Juliette Jolivet. Il a choisi de récompenser du Grand Prix l’étonnant Désordres (en salles le 12 avril 2023), fiction réalisée par le réalisateur suisse Cyril Schaüblin. L’action est située dans la vallée de Saint-Imier, dans le Jura suisse. Cette localité a la particularité d’être à la fois une ville horlogère industrielle et un berceau de l’anarchisme dans la continuité de la Première Internationale. Protagoniste principal, le voyageur et cartographe Piotr Kropotkine est un étranger qui accompagne les spectateurs·trices dans la découverte de la ville. Faisant écho au travail cartographique de Kropotkine, le film tisse patiemment sa toile : le géographe souhaite établir des cartes anarchistes. Plus proches de la réalité des gens, cette cartographie populaire refléterait non plus la vision du pouvoir (policier, militaire, administratif, bref de l’État) mais celui de la population locale, en situant par exemple les « lieux-dits » (comment les habitant·e·s désignent certains lieux). Le principe de la cartographie anarchiste, expliqué à la fin de la première demi-heure, devient pour Cyril Schaüblin un véritable principe de mise en scène. C’est ainsi que Kropotkine se déplace à travers la ville, discutant et expliquant sa démarche avec les habitant·e·s, naviguant lentement de la gare à l’usine en passant par l’auberge et la forêt.


Mais le film laisse souvent de côté son personnage principal pour donner à voir une multitude de personnages secondaires, dressant un portrait collectif de la ville par ses habitant·e·s, du photographe de rue aux employées opérant le télégraphe. Les séquences les plus inattendues sont sans doute celles dans l’usine d’horlogerie auprès des ouvrières. Le cinéaste pratique ici l’hypotypose, décrivant cinématographiquement avec précision et détail leur travail manuel sous toutes ces formes : des gros plans sur leurs mains réglant les mécanismes des montres jusqu’au monologue de Joséphine, jeune ouvrière expliquant à Kropotkine son travail de « régleuse » qui fabrique le balancier, élément essentiel de la montre (le balancier donne par ailleurs son titre original au film : Unrueh). La photographie douce et peu saturée magnifie la reconstitution méthodique des décors d’époque, d’une rare clarté. Au-delà de ce labeur manuel, la structure narrative décousue laisse peu à peu entrevoir la propagation des idées socialistes et anarchistes. Dans l’usine ou à l’auberge, les habitant·e·s échangent et remettent en question l’ordre établi. Se produit alors le dérèglement progressif de la mécanique sociale alors que la conscientisation politique s’étend. Les personnages secondaires se rencontrent et mènent souterrainement une révolution qui ne sera jamais une insurrection, mais qui provoquera une réaction des autorités (patrons, policiers, etc.) dans la deuxième moitié du film.

Là où Désordres surprend le plus est dans sa liberté formelle en digne héritier de Peter Watkins, multipliant les plans d’ensemble ou de demi-ensemble pour intégrer les personnages dans leur environnement, les réduisant parfois à une place réduite dans le cadre. S’en dégagent des plans séquences quelque part entre les photographies du XIXème siècle et les plans Lumière. La profondeur de champ est utilisée dans tout son relief avec une chorégraphie de figurant·e·s passant dans l’arrière-plan ou en amorce, faisant de la ville non pas un décor mais un organisme foncièrement vivant. Les décadrages sont fréquents et l’action ne démarre pas au début du plan mais parfois, laissant vivre la ville. Dans l’auberge où se réunissent les hommes, une conversation n’est ainsi pas filmée à un mètre mais à dix mètres. Ce qui n’empêche pas Cyril Schaüblin de s’approcher ensuite de ses personnages avec des plans rapprochés, comme un effet de loupe qui est aussi un moyen de mieux les écouter. Les dialogues du film surprennent par un réalisme éthéré et porté par des interprètes non-professionnels. Toujours dans cette esthétique watkinssienne, l’effet de réel sur le langage ainsi insufflé participe de notre inclusion dans le quotidien comme pourrait le faire un documentaire. La révolution politique à bas bruit qui s’instaure permet à Désordres d’appliquer esthétiquement les idées anarchistes dans sa forme même.
Second film primé, Fragile Memory est salué par une mention spéciale du jury. Pourtant, le drame d’une bonne sélection est qu’elle fait ressurgir les films moins convaincants. Dans ce documentaire, le cinéaste ukrainien Igor Ivanko dresse un portrait intime de son grand-père, Leonid Burlaka, chef opérateur virtuose ayant fait les plus belles heures du studio cinématographique d’Odessa entre les années 60 et la fin des années 1990. Âgé de plus de 80 ans, il perd ses capacités cognitives et la caméra de son petit-fils met à nu son incapacité à comprendre des questions basiques comme la dégradation de sa mémoire. Après avoir retrouvé une pellicule de clichés dégradés par le temps (champignons) ou tout simplement effacés du support, Igor Ivanko entreprend de questionner son grand-père sur sa carrière. L’ensemble du film est construit comme une métaphore sur la mémoire « fragile » du grand-père qui décrépit, tout comme celle de l’histoire du cinéma ukrainien (selon lui injustement oubliée) ; les deux pouvant être réhabilitées sinon sauvées (et le seront par le cinéaste) en sauvegardant et exposant les archives (du grand-père comme du studio d’Odessa).


Le film interroge le cinéma soviétique (dans lequel était dissous le cinéma ukrainien) lorsque Igor Ivanko demande à son grand-père quelles étaient les censures au VGIK, la mythique école moscovite, ou ce que son aïeul pense du cinéma de propagande industriel auquel il a participé. Malgré ces enjeux politiques et mémoriels, Fragile Memory est évidemment un prétexte du petit-fils pour partager les derniers moments avec son grand-père. Le documentaire émeut par instants, comme lorsque la grand-mère d’Igor profite de l’absence de Leonid pour confier que le pire est que son mari est conscient de sa déliquescence. Ou lorsque Leonid, confronté à une photo de sa fille, ne se souvient plus qu’elle est sa benjamine mais est profondément ému par sa beauté. Mais trop de séquences répètent les mêmes moments gênants où Leonid est incapable de se souvenir ou même de comprendre les questions de son petit-fils. L’observation tendre et crue d’une fin de vie tire en longueur, transformant l’expérience du spectatorielle en une longue agonie d’1h25, là où l’hommage du petit-fils à son grand-père aurait pu être contenu entre 30 et 50 minutes. Fragile Memory souffre de ce montage trop long et conventionnel, voulant tout mettre et ne se posant pas assez la question de la juste distance. Comment fallait-il montrer ces images filmées d’aussi près ?
À la même question, un autre documentaire a sans doute trouvé de meilleures solutions. Dans le magnifique How To Save A Dead Friend (disponible sur Arte.tv jusqu’au 18 février 2023), Marusya Syroechkovskaya mobilise quinze années d’archives filmées de son quotidien d’adolescente moscovite. Autoportrait, le documentaire saisit par sa force vitale malgré le spectre livide qui le traverse. Le film d’une survivante : « Mes amis se suicidaient » confie la cinéaste dès les premières minutes de ce film d’1h43. Qu’est devenue cette génération née au moment où l’Union Soviétique disparaissait, qui a eu son enfance dans les années 1990 où apparaissait la Fédération de Russie puis son adolescence dans la première décennie d’un nouveau siècle marquée par Poutine ? Parmi ces amis, son premier grand amour, Kimi, au cœur du film, il est cet « ami mort » dont le prologue montre l’enterrement. La réalisatrice ouvre ses archives comme on ouvrirait un tombeau. Kimi est déjà mort au début du film, déjà mort de l’intérieur, déjà condamné comme tous les jeunes de sa génération. « C’est ressusciter qui est difficile » explique le frère aîné de Kimi quand il lui est demandé s’il a peur de la mort. Le film est une resurrection numérique pour Kimi et cette génération décédée avant de vivre. Derrière ce montage classique qui retracera ensuite chronologiquement la vie de Kimi, Marusya Syroechkovskaya et son monteur Qutaiba Barhamji (ayant travaillé sur Little Palestine, journal d’un siège en 2021) revisitent avec une grande inventivité formelle le destin croisé de Marusya et Kimi.

Davantage qu’un autoportrait, How To Save A Dead Friend est un journal intime rendu public, dans la grande tradition de ce genre documentaire. Photographies d’un petit appareil reflex et rushes de la caméra DV constituent le matériau de ce journal autofilmé certes, mais tourné vers l’autre. Encore lycéenne, Marusya aspirait à devenir cinéaste. Elle entreprend alors de filmer son quotidien : concerts, soirées, discussions dans la cuisine, réveils, bêtises du chat adopté. Au montage, sa voix off fait le lien entre les images, bouche les trous, contextualise, explique, glisse une anecdote, tout en mettant de la distance. Ce n’est plus la même Marusya : celle qui commente est une jeune femme trentenaire devenue cinéaste tandis que celle qui a filmé n’est qu’une adolescente devenant peu à peu adulte. La réflexivité ainsi insufflée par ce commentaire n’est jamais lourde et sert au contraire un récit prenant, rythmé, sans temps mort, drôle et émouvant, toujours pudique. Le récit est pourtant entraîné dans la chute de Kimi, son « autodestruction grandissante » comme l’analyse Maryusa. Passé les premières séquences plus légères montrant l’apogée d’un amour passionnel, la gravité reprend le dessus : dépendance à la drogue, absence d’avenir, et morts en série. Lorsqu’il apprend la mort d’un ami, Kimi n’est même plus surpris. Les discussions les plus ouvertes sur la mort se font de plus en plus nombreuses. Loin d’être un tabou, la mort est un événement quotidien et banalisé : « La mort est la troisième naissance » philosophe Kimi tandis que mourir d’une overdose lui inspire cette réflexion pragmatique : « tu disparais juste, comme s’endormir sans se réveiller ».

Malgré cette surabondance de thèmes liés à la mort, Marusya Syroechkovskaya évite de faire de son film une autopsie strictement glauque. L’intime n’a jamais été aussi politique : la dictature rampante en Russie et la montée du discours nationaliste ont aussi été archivées cinématographiquement par la cinéaste en devenir. Des discours télévisés vus en famille : le premier de Poutine en 1999 ou celui de Medvedev devenu président en 2012. La caméra zoome jusqu’à faire le point sur les luminophores du tube cathodique, comme pour percer la vérité derrière l’écran. Mais Maryusa filme aussi des arrestations et répression dans les rues de la capitale. Plus encore que le pouvoir politique, c’est la société russe dans son ensemble qui est examinée, variation macroscopique du Suicide d’Emile Durkheim l’étude fondatrice de la sociologie moderne. Un pays surnommé par Kimi la « Fédération de la Dépression ». En surimprimant un gros plan du visage de Kimi avec les immenses barres d’immeubles du quartier de Butovo à Moscou, Marusya Syroechkovskaya souligne les déterminismes sociaux à l’œuvres pour les oubliés de ce quartier populaire. Pourquoi avoir tout filmé avec une si grande rigueur sur tant d’années ? Maryusa s’est-elle filmée en train de vivre ou bien en train de mourir ? A-t-elle voulu archiver sa survie ? Fait-elle de la création (filmer puis monter) une expérience thérapeutique ? How To Save A Dead Friend, plus encore que l’ambition programmatique de son titre (sauver son ami en l’immortalisant par le film ?), transforme les souvenirs les plus douloureux en une célébration de l’amour et une ode à la résistance.
À l’autre bout du spectre, filmant non pas un proche mais un étranger absolu, dans une forme ramassée de 10 minutes, Marie Chemin propose un étonnant desktop movie : Le fantôme de Marioupol. La jeune cinéaste navigue avec son ordinateur dans Google Street View où Andreï, habitant de Marioupol, a mis en ligne des clichés de sa vie et de sa ville, détruite en mars 2022 par l’armée russe lors de l’invasion de l’Ukraine. Pris avec une fonction 360°, les photos sphériques sont visitées par Marie Chemin en faisant des panoramiques (latéraux, verticaux, en diagonale) ou des zooms dans l’image lorsqu’elle enregistre l’écran de son ordinateur. Le film devient une exploration spatiale et géographique à travers ces clichés quelconques du centre-ville de Marioupol comme de la campagne où la famille d’Andreï semble aller en vacances. Les empreintes d’Andreï dans l’image sont inspectées, à l’instar du VTT qu’il semble utiliser pour se déplacer et qui se retrouve dans le « cadre », ou plutôt la sphère photographique. La beauté des paysages est magnifiée par cet usage ultramoderne du panoramique, malgré la qualité limitée de l’appareil utilisé par Andreï.

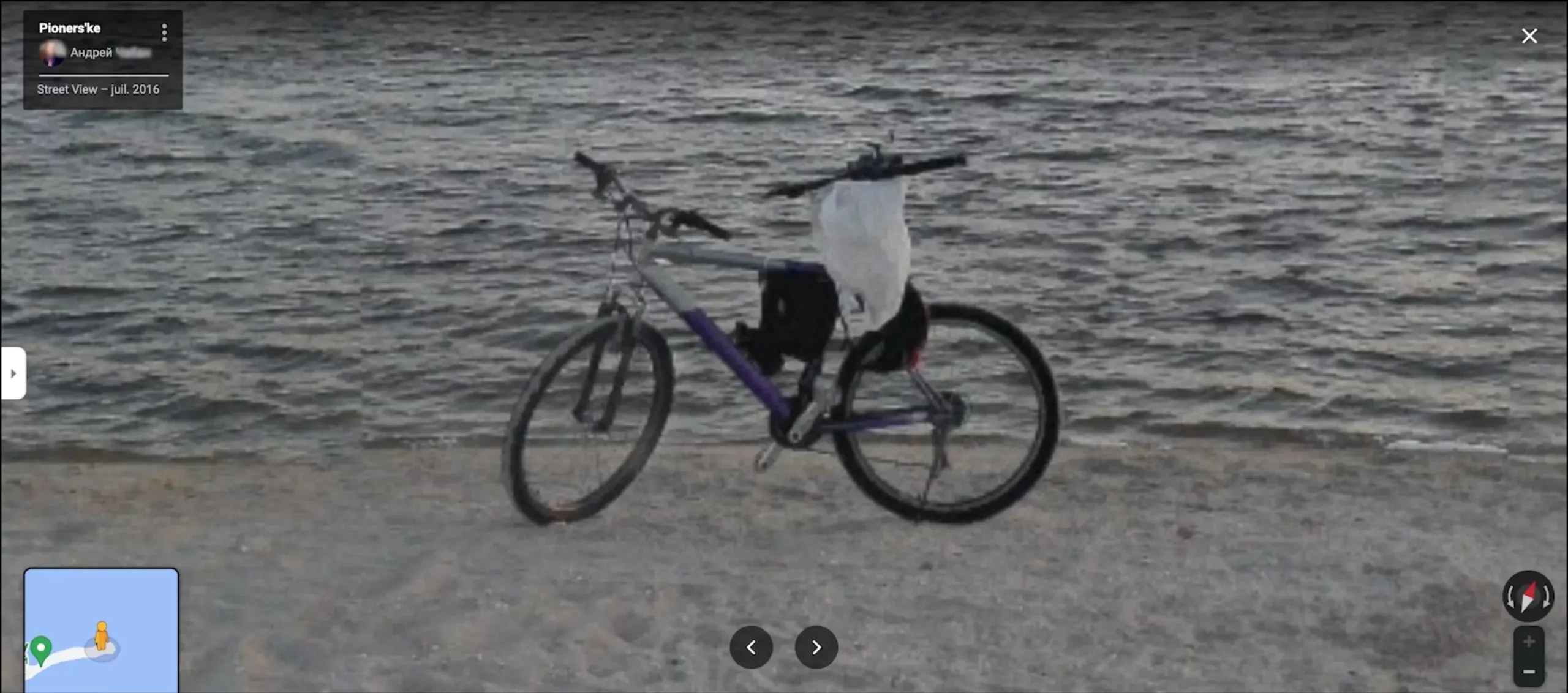

Alors que l’enquête aurait pu rester dans cette forme réaliste, le desktop movie emprunte un chemin plus fantastique et les fantômes du film apparaissent de nombreuses manières. La technique utilisée par la fonction photo 360° du téléphone d’Andreï laisse apparaître des glitch : bouts de corps fusionnés entre eux, tordus, coupés ou fondus dans leur environnement. Andreï devient un sujet absent : la cinéaste suit ses traces, ces archives publiques témoignant d’un passé révolu par la guerre. Pourtant, les stigmates sont déjà présents. La guerre pour le Donbass a débuté en 2015 et une photo d’Andreï dans une caserne militaire témoigne de cette réalité. Poussant sa recherche au bout, Marie Chemin contacte Andreï sur Facebook, mais il ne répond pas, doublant son absence d’une disparition — il ne publie plus de photos. La voix-off de la cinéaste-narratrice explique en quelques mots sa démarche et ses interrogations : pourquoi Andreï filme-t-il ? Que pensait-il à ce moment-là ? Qu’est-il devenu ? Entraînant le spectateur dans son investigation obsessionnelle, la cinéaste transforme son enquête visuelle en quête métaphysique. Andreï, d’un sujet lointain et étranger devient si proche et familier.
Comment faire film lorsque l’on est pas sur place ? Alors que Marie Chemin prend le parti du found footage, exilé à Berlin, le réalisateur Pavel Mozhar effectue dans Handbuch un travail de reconstitution des pratiques de torture de la police politique de Biélorussie. Dans cette ancienne république soviétique, la réélection à 80% du président-dictateur Alexandre Loukachenko, largement contestée en raison de la fraude électorale massive, a été soutenue par le régime russe et contestée par les opposants politiques. Dans une pièce vide aux murs blancs, avec deux acteurs·trices, le réalisateur détaille les gestes effectués par les tortionnaires aussi bien à l’image qu’avec, en voix off, les paroles des personnes torturées. « Tout est douloureux », expliquent ces prisonnier·re·s politiques emprisonnés pour des infractions de plusieurs classes. Un homme masqué encagoulé joue le rôle de l’homme de main et mime avec une matraque les coups portés. Mais le plus saisissant est sûrement quand la voix off explique que les moments les plus éprouvants sont ceux où les corps sont mis dans des positions totalement inconfortables : les mains derrière le dos créant une pression sur les épaules ou l’inclinaison de la tête contre le sol provoquant une douleur extrême.

Les chiffres donnés parviennent à prendre la mesure de ces journées de torture : trente personnes dans une cellule de 4 par 2,5 mètres, un litre d’eau pour la même cellule, seulement quatre lits… Chaque phrase est plus glaçante que la précédente. La rigueur des cadres de Pavel Mozhar pourraient faire penser à une vidéo de formation pour tortionnaires grâce à la précision des méthodes. En réalité, la discipline qu’il applique dans la reconstitution transforme son film en anti-manuel de torture. Dans les plus beaux moments de ce film de 26 minutes, son ambition humaniste rejoint l’héritage de Robert Antelme qui témoignait en 1947 dans L’Espèce humaine autant des mécaniques de l’horreur que de la solidarité qui peut émerger du pire. Les camps de torture biélorusses ne sont les camps de concentration nazis. Mais la mécanique de la terreur porte en comme une profonde inhumanité dans laquelle l’entraide et l’humour peuvent renaître. Comment tenir quand il fait froid ? Un cercle des prisonnier·re·s leur permet de se réchauffer. Le lien unissant Mozhar à Antelme se prolonge surtout dans le dépouillement esthétique dont ils font preuve. La simplicité de la « mise en scène » d’Handbuch permet à cet essai documentaire de se rapprocher de l’expérience vécue, sans jamais l’atteindre, mais toujours avec un esprit de résistance.
« On a plus d’eau ! » : avec Virée sèche, court-métrage de fiction produit par le GREC, Théo Laglisse filme une Marseille dystopique où plus une goutte d’eau potable n’est disponible. Au milieu d’une rave party, Jordanne et son amie partent dans cette quête impossible, alors que la mer s’étend à perte de vue mais s’évapore. Leurs déambulations, errances et courses dans la cité phocéenne se font au rythme de la musique hardtechno / gabber du collectif Southfrapp Alliance et d’effets sonores accentuant leur angoisse ou mimant les effets des psychotropes ingérés dans les heures précédentes. Renouvelant ainsi le film psychédélique, la mise en scène hallucinée est portée par le choix d’un smartphone comme appareil de prises de vues. À l’image de Sean Baker et son iPhone 5 à Los Angeles dans Tangerine (2015), le smartphone devient une caméra hyper-maniable, épousant tous les mouvements des personnages, en extérieur comme en intérieur, avec des transitions rarement vues sinon dans des films d’action au budget cent fois supérieur à ce court-métrage de 23 minutes.


On frôle régulièrement le malaise devant tant d’acrobaties : la caméra virevolte, oscille, titube, tangue, se rapproche, s’éloigne, suit les courses effrénées des personnages avec un caddie et manque de chavirer avec les personnages. Les déformations optiques causées par le choix d’une focale courte sont de plus accentuées par des effets spéciaux transformant les arrières-plans du centre-ville de Marseille en murs mouvants et flous. Au duo d’adolescents, le cinéaste a eu la bonne idée d’ajouter le personnage de Chléo (petite soeur de Jordane), apportant d’abord par sa sobriété (contrairement aux jeunes drogué·e·s au milieu d’une seconde rave party) un décalage et des scènes drôles aux répliques bien senties (« Tu crois qu’ils auront des Mr.Freeze à la plage ? »). Surtout, Chléo provoque le deuxième mouvement au récit en enjoignant à l’action ses ainé·e·s (dans un parallèle revendiqué et un peu facile avec Greta Thunberg). Le film affirme par tout cela un propos politique évident. L’urgence climatique est ici traitée comme une urgence vitale pour des personnages au bord de la mort car assoiffés. Derrière la forme frénétique et extravagante de Virée sèche, Théo Laglisse ramène paradoxalement le film catastrophe dans son style le plus réaliste.
Dans Astrakan (en salles le 8 février 2023), David Depesseville dessine le portrait sensible de Samuel (Mirko Giannini), enfant placé dans une famille rurale du Morvan. Orphelin, il rejoint un foyer composé d’une fratrie et deux parents. Marie et Clément ont accueilli Samuel par nécessité financière (l’allocation versée en échange de cette prise en charge), mais le considèrent peu à peu comme un troisième fils. Malgré tout cela, Samuel demeure de fait un étranger dans cette famille. L’ensemble du film joue sur les ambiguïtés des personnages et leurs difficultés à s’exprimer ou à se comprendre. Traité d’enfant possédé, il sera soumis à un exercice d’exorcisme et sera battu par Clément (le père) lorsqu’il souille (à nouveau) ses sous-vêtements en n’allant plus aux toilettes. Mais Clément fera des heures supplémentaires à l’usine pour lui payer un voyage au ski avec sa classe. Le récit est riche de toutes ces couches et de ces nombreuses branches, évitant le huit clos et s’étendant même sur plusieurs saisons (l’été, l’automne, l’hiver). Samuel grandit, s’épanouit dans le sport ou avec sa première amourette. La mise en scène, âpre sans être abrupte, nous plonge dans un état de gêne et de malaise quelque peu étrange. L’équilibre est ténu entre la dureté (voire la violence) des épreuves traversées et les quelques moments de grâce (dont les dix dernières minutes, surprenante apothéose en musique). Mais le film, qui pourrait dégoûter, ne sombre jamais dans le misérabilisme.

Au contraire, sa description précise de conditions sociales (créant la situation de Samuel et sa place dans la famille) fait d’Astrakan un film mobilisant l’intime pour parler moins frontalement de politique. Si l’intrigue se débarrasse des institutions (la justice pour enfants, l’aide sociale à l’enfance, la police, notamment), c’est pour mieux ausculter le corps social que représente la famille. Un noyau à l’échelle de la société, mais un océan à l’échelle d’un film. Au film « de société », suivant à un cahier des charges attendu sur un sujet, David Depesseville répond par l’attention portée à ses personnages. Jamais complément détestables, pas non plus monolithiques. L’apparente sobriété de la mise en scène cache une grande précision dans le découpage et quelques plans marquants. L’intemporalité du récit (nous pourrions être en 1980 comme en 2000 ou en 2020) est renforcée par le choix d’un support 16mm granuleux. Dans cette matière riche, les couleurs ont été intensifiées à l’étalonnage : le vert omniprésent dans les extérieurs, la beauté des nuances de neige, les intérieurs sombres et denses. Les plus beaux plans du film demeurant sans doute ceux sur le visage de Samuel, dans toutes ses nuances, de la peur à la détresse en passant par l’impassibilité jusqu’à ses rares sourires. « Tu sais Sam, c’est quand tu souris qu’on voit qui tu es » lui dira sa voisine et petite amie.

En retrait dans cette sélection, Nocturnus, court-métrage insipide de 21 minutes tourné en 16mm dans l’Arctique par Harm Dens et Meltse Van Coillie. Des scientifiques observent les habitants qui hibernent dans des petites cabanes. Le seul intérêt du film est de voir comment réagit la pellicule à ces plans tournés uniquement dans une nuit noire avec quelques lampes torches brûlant le support. L’ajout d’une intrigue et d’acteurs·trices professionnel·le·s avec des dialogues surjoués empêche sûrement cette courte fiction d’atteindre la part de mystère et de tension qu’elle recherchait.
